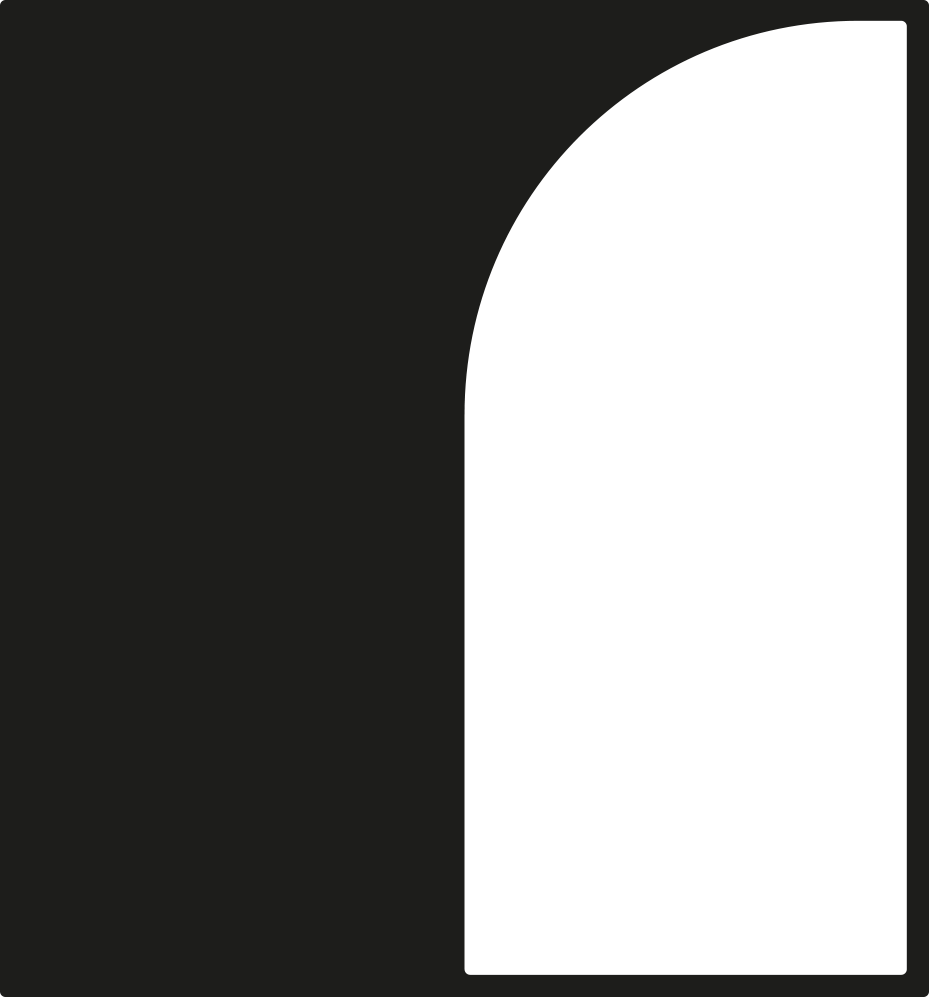INTERVIEW
MARCELLA BARCELÓ EN CONVERSATION AVEC HERVÉ MIKAELOFF ET ELISE ROCHE
L’artiste doit suivre l’esprit de la nature qui est à l’oeuvre au coeur des choses et ne s’exprimer par la forme et le dessin que comme s’il n’était question que de symboles. Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph, Des Rapports des Beaux-arts et la nature, 1807
Habiter le monde n’est pas chose aisée ; il est parfois désenchanté et livré à nous sans aucune précaution poétique. Sans crier gare, il arrive pourtant que le merveilleux puisse s’inviter dans nos esprits au contact du Beau. C’est bien de cette expérience qu’il s’agit lorsqu’on se laisse aspirer dans l’oeuvre de Marcella Barceló. Nos premières rencontres datent de 2020, elles sont fugaces mais nous marquent déjà profondément. Le lien se resserre à l’occasion de l’exposition Miss Dior au château de la Colle Noire puis lors de l’édition d’Art Paris 2021 où nous l’inscrivons dans le parcours curatorial « Portrait et figuration, Regard sur la scène française. ». C’est donc tout naturellement que nous avons accepté l’invitation de FORMA à retranscrire nos échanges avec l’artiste pour son exposition personnelle.
• Peux-tu nous dire comment s’est construite l’exposition ? Comment as-tu sélectionné les oeuvres exposées ?
L’ensemble des peintures datent de cette année et de la fin 2021. Ulysse Geissler et Aurélien Jacquin m’ont aidée pour faire la sélection à l’atelier qui était saturé. Je n’y voyais plus rien, j’ai eu besoin de leurs yeux de confiance pour démêler l’ensemble. C’est après que j’ai pu voir le fil qui reliait une peinture à l’autre et qui m’a mené au titre de l’exposition, Locus Amoenus.
• Oui d’ailleurs, d’où vient ce titre « Locus Amoenus » ? À quel imaginaire ou mythologie est-il emprunté ?
J’interprète le topos du Locus Amoenus comme un lieu idéal donc utopique, qui n’existerait pas, un paradis qui ne pourrait être perdu car il n’aurait jamais existé. Je me suis approchée de ce titre en m’intéressant aux représentations du paradis (jardin clos de l’Eden, et représentations d’Adam et Ève). Le jardin pourrait être un résumé symbolique du monde et de ses éléments : un espace limité qui contiendrait le monde résumé, comme certains jardins japonais, comme L’Aleph de J.L. Borges. C’est aussi pour moi le lieu mental, comme on dit en français le jardin secret, un lieu de contrôle et de liberté, similaire à l’équilibre d’un peintre dans l’atelier. L’Éden est aussi ce jardin clos, hortus conclusus, un idéal de protection contre les attaques du réel extérieur.
• Comment émergent les scènes qui figurent sur tes toiles ? Est-ce à partir de souvenirs, de photographies, de références cinématographiques ?
Je pars du hasard et d’une pulsion, une envie de couleur ou de texture, de coulures verticales ou de jaune doré, comme une envie de fraises ou de jus de tomate, un craving. Je pars de ce fond toujours rapide et sans contrôle, j’en prépare plusieurs en même temps, c’est le moment de l’urgence. Je ne sais jamais ce qui va émerger à ce moment, c’est l’instant le plus chaotique, comme un Big Bang. Je pense à la naissance de Vénus décrite dans la théogonie d’Hésiode, l’image pure qui apparaît dans un mélange de fluides corporels et d’écume marine. La peinture pourrait être ça, le cocktail de la pensée rationnelle humaine avec les éléments qui nous entourent. Il y a quelque chose de l’alchimie, mais sans son dosage juste, sans quête précise, en tout cas je n’ai pas l’idée de ce que je cherche en allant chaque jour à l’atelier. C’est une obsession sans nom, peut-être une recherche d’invisible, comme tenter de me souvenir de mes derniers rêves.
Je vois mes figures non comme des corps mais plutôt comme des personnages. J’espère que le fait qu’ils ne soient que peu détaillés, ou qu’ils soient parfois non genrés puisse permettre au spectateur de s’y identifier. C’est aussi pour cela que je ne représente presque essentiellement que des corps transparents, indéfinis dans leur identité et dans leur matérialité picturale, mais aussi du fait que je ne représente que des corps adolescents, indéfinis aussi car non finis, en mutation, sans caractère sexuel trop visible.
Je ne prends pas de drogues mais j’imagine que la quête est similaire, trouver une réponse à une question que l’on n’arrive pas à formuler, et chaque jour une nouvelle question inconnue avec l’espoir de sa réponse incertaine : c’est ce mécanisme infini qui me fait me lever chaque matin.
Les figures arrivent comme un jeu ; c’est comme placer un santon dans une crèche de Noël, à tel endroit, un peu plus gauche de l’arbre peut-être ? Je m’inspire de poses trouvées dans des livres de références pour mangaka ou bien dans des illustrations de mode des années 60 dans lesquelles les figurines de papier sont à découper. J’aime ces corps de poupée, façon monde miniature. Je les place au milieu du tableau comme si je les avais découpées autre part.
J’ai envie d’exprimer cette sensation d’être un peu perdue, de ne plus comprendre le monde qui nous entoure, mais je pose aussi la question du commencement, d’où les allusions à l’Éden : l’impulsion d’un dieu plaçant l’homme, comme une poupée, au milieu d’un jardin. Comment exister dans ce monde qui nous échappe, comment se maîtriser dans l’immaîtrisable ?
• Tu avais évoqué lors d’une de nos conversations ton enfance dans un endroit isolé proche des montagnes et de la mer. Peux-tu nous en dire un peu plus et par extension nous parler de ton rapport à la nature ? En observant tes oeuvres, on ressent en arrière-plan que l’imminence d’une catastrophe plane toujours. La notion d’impermanence est diffuse dans ton travail.
De là-bas, la vue était courbée, comme si on pouvait voir l’arc de la surface de la terre. L’agencement des montagnes derrière la baie, la brume qui les cachait parfois, les étoiles des ciels sans lune mais que l’on voyait de moins en moins bien d’année en année à cause des lumières humaines de plus en plus présentes. Je me souviens de cette inquiétude à la vue des nouveaux bâtiments construits chaque été pour les touristes. Ils se multipliaient, et avec eux les débris plastiques sur les plages, les méduses qui proliféraient. Il y a un terme très présent aujourd’hui, et qui exprime ma sensation à posteriori : celui d’éco-anxiété.
Je représente effectivement beaucoup de ciels qui peuvent évoquer l’instant juste avant ou après l’orage, le temps d’avant le basculement, la seconde où l’on sait que rien ne sera plus comme avant. Mon obsession pour les volcans va aussi dans ce sens : j’essaye de capter l’impermanence, celle d’un danger toujours présent et possible, d’un grand chamboulement, une montagne majestueuse qui pourrait éclater à tout moment.
C’était un cauchemar que je faisais souvent, enfant : la montagne derrière notre maison qui s’éventrait, le rouge de la lave qui apparaissait. Il y a souvent des incendies à cause de la sécheresse l’été à Majorque : c’est une vision spectaculaire et terrifiante, le feu qui s’approche, la force du vent et ce que l’on y trouve les lendemains : les squelettes des arbres noirs, l’odeur des tortues calcinées et la beauté dans l’espoir de ces petites pousses quelques mois après. Ma mère me disait que ce ne serait plus comme avant, que cela prendrait du temps, mais que dans quelques années peut-être ces amandiers seraient à nouveau en fleurs.
• Tu figures par ailleurs une nature qui est souvent idéalisée, presque artificielle, pourquoi ?
J’ai le sentiment que la nature est devenue artificielle. Il est difficile de trouver des lieux préservés de nous. On trouve un peu partout entre les coquillages des fragments plastique fluo. Certains enfants ne le croient pas quand on leur dit que leurs poissons panés savaient nager avant d’être tués. On induit les huîtres à former des perles en forme d’étoile, les arbres à se tenir droit et en ville on ne sait plus si les oiseaux que l’on entend annoncent vraiment le printemps ou bien la sonnerie d’un iPhone.
Plastiquement, je pense avoir été très influencée et marquée par ce passage du noir et blanc à la couleur dans le magicien d’Oz : l’apparition de ce décor en Technicolor aux fleurs plastiques irisées sous les projecteurs, semblables aux fleurs géantes d’Henry Darger. J’ai aussi beaucoup appris des compositions de paysage de l’ukiyo-e1, où arbres, nuages, montagnes, le haut et le bas, se confondent et se mélangent : une vision un peu floue et vaporeuse du monde. Il y a un mot anglais qui synthétise pour moi cet état de vision confuse : light-headed.
• On constate une évolution dans ta pratique : la palette de couleur se diversifie, des personnages masculins apparaissent pour la première fois, de même pour certains animaux… Comment la série des dinosaures est-elle née par exemple ?
Je suis souvent attirée par une forme d’abord, la courbure du dos d’un diplodocus, une fleur simili feu d’artifice, le cyprès pointu fait d’un coup de pinceau. Plus tard, je vois la symbolique de ces éléments. Par exemple, la fleur de l’agave dans Golden and blue Hours, est une plante monocarpique, c’est-à-dire qui ne fleurit qu’une fois puis meurt juste après. Sa floraison signe donc sa mort. C’est la même beauté fugace que la vision d’un feu d’artifice, que je représente par exemple dans Wallflower. Le symbole du feu d’artifice est pour moi comme un état confus de frayeur et de joie.
• Le format de certaines toiles exposées est étonnant, on pense notamment à Golden and Blue Hours, ou For ever and ever. La technique est elle aussi particulière : tu peins à l’acrylique mais pas uniquement. Tu nous avais montré tes vernis à ongles à l’atelier. Comment t’est venue cette idée ?
Comme beaucoup d’enfants, lorsque je m’ennuyais à table, je dessinais avec les restes de moutarde ou le vin qui tachait les nappes des fins de repas : j’oublie encore parfois que telle tache de couleur n’est pas un pot de peinture. Pour le vernis à ongle c’est similaire, je me mettais du vernis irisé et cette couleur était si particulière que j’ai voulu l’intégrer dans une peinture, un geste irréfléchi, comme les dessins distraits automatiques que l’on fait lors d’un long appel au téléphone : il crée cette touche de lumière et de volume qui diffère de l’acrylique et de l’huile. Je l’utilise par petits points, comme un ornement, ce qu’il est censé faire pour le bout de nos doigts. La saturation à certains endroits de mes peintures est je pense volontairement ornementale, comme le serait le plumage du paon, démesuré, comme une femme très maquillée, parée, qui se représenterait elle-même.
• L’exposition est pensée depuis quelques mois et pourtant la proposition d’oeuvres mue au fur et à mesure des réflexions communes. Pourrais-tu nous parler de ta pratique du dessin ? Pourquoi était-il important de l’incorporer à cette histoire ?
Ma pratique principale était encore il y a deux ans le dessin, aujourd’hui c’est la peinture. Je n’envisage pas mes dessins comme des croquis préparatoires mais c’est souvent les journées où je ne vais pas à l’atelier que je dessine, chez moi ou en voyage, et qu’arrivent de nouveaux éléments picturaux. C’est ces dessins qui m’ordonnent de retourner rapidement à l’atelier, car je dessine vite et j’accumule donc beaucoup d’envies d’images, à agrandir, à répéter. Ils sont ce que l’on pourrait appeler des idées.
• D’où tes titres trouvent-ils leurs origines ? Insulin, Full Moon Sleepless…?
C’est un exercice qui me déplaisait autrefois, celui de donner un titre. J’avais peur qu’il enferme les possibilités de l’image. Aujourd’hui, je réalise que les titres me permettent d’ajouter des fenêtres de possibilités, qu’ils sont aussi utiles qu’une couleur. C’est souvent au dernier moment dans l’urgence que je les trouve, avant que les peintures ne quittent l’atelier. Ils évoquent le plus souvent ce que j’y vois à un moment précis, comme deux nuits d’insomnie (Full Moon Sleepless). Quelques titres sont aussi tirés de mes lectures du moment, le plus souvent de poèmes (Wallace Stevens, Sylvia Path, Antonio Machado, les Métamorphoses d’Ovide, entre autres…)
• Maintenant que nous avons évoqué la nature qui t’est si chère, peux-tu nous présenter ces êtres qui peuplent tes tableaux ? Les corps semblent n’être réduits qu’à leurs contours, comme si ne comptaient finalement que leurs essences.
Je vois mes figures non comme des corps mais plutôt comme des personnages. J’espère que le fait qu’ils ne soient que peu détaillés, ou qu’ils soient parfois non genrés puisse permettre au spectateur de s’y identifier. C’est aussi pour cela que je ne représente presque essentiellement que des corps transparents, indéfinis dans leur identité et dans leur matérialité picturale, mais aussi du fait que je ne représente que des corps adolescents, indéfinis aussi car non finis, en mutation, sans caractère sexuel trop visible.
Les poses de mes figures sont assez statiques, le plus souvent de face, comme si elles se présentaient. Je collecte beaucoup d’images de films de yūrei (films de fantômes japonais), et c’est cette pose, droite, les bras le long du corps, qui est souvent utilisée lors de l’apparition de l’entité (la plus connue, Sadako dans The Ring). Je représente rarement les pieds de mes personnages. Comme les estampes de yūrei, c’est une manière de signifier que le fantôme n’est pas de notre monde, n’a pas les pieds sur terre. Mes personnages sont souvent transparents, des corps sans organe ou transparence fantomatique : je les envisage plus particulièrement comme des ikiryō. Les ikiryō sont des fantômes de personnes encore vivantes, une possibilité de se dupliquer et de hanter d’autres lieux. Je dis souvent que ces personnages dans mes peintures sont un peu des ikyriō de moi-même. Matériellement, ils sont aussi présents dans un lieu presque vide, là où il y a le moins de matière, le moins de peinture. C’est la peinture autour qui les fait apparaître en s’arrêtant à leur contour. Ils sont semblables à des traces, comme lorsque l’on retire une feuille d’arbre du sol un jour de neige, la silhouette de vide qui reste dessinée, sa mémoire. C’est de cette manière que j’envisage les souvenirs, comme des empreintes, comme des fantômes.
• Il y a effectivement une dimension presque magique et protectrice dans tes oeuvres. Pouvons-nous dire que tu as une vision animiste du monde ? Quel est ton lien au spirituel, au sacré ?
En découvrant le shintoïsme, j’ai fait le lien entre mon rapport à la nature et les kamis (divinités du shinto). Ces derniers se cachent partout, ils sont ambivalents : bénéfiques mais aussi parfois d’une grande violence, comme la nature : la pluie fait pousser nos champs mais peut aussi les inonder.
Je vois par ailleurs parfois l’acte de peindre comme un art divinatoire : la part d’incontrôlé dans la peinture, les accidents et les images qui en résultent seraient comme le hasard d’une lecture dans les feuilles de thé, dans les traces de pas d’un renard. On y voit ce qu’on n’aurait pas pu trouver sous le contrôle et sans paréidolie. Pour moi, le pouvoir des images est de dissimuler plus facilement des secrets que ce que permettent les mots, ces derniers ayant une définition inscrite dans les dictionnaires. Les formes et les couleurs sont plus libres et peuvent contenir des symboles distincts, qui s’accouplent et mutent. Par ailleurs, mes proches m’avouent souvent trouver des secrets ou des souvenirs communs dans mes peintures et dessins, des choses intimes que l’on ne raconte pas aux inconnus. J’y loge effectivement beaucoup de souvenirs, mais déformés, comme les fragments récupérés d’un rêve ou l’idée un peu bachelardienne que tout serait rêvé avant de pouvoir être vu.
La peinture est née de croyances animistes, religieuses, et j’espère aujourd’hui qu’elle puisse conserver la magie d’un fétiche, un mélange de matières et de pensées, que l’on tend souvent à oublier dans notre monde saturé d’images immatérielles et rapides. J’aimerais bien que mes peintures deviennent un jour des tsukumonogami.